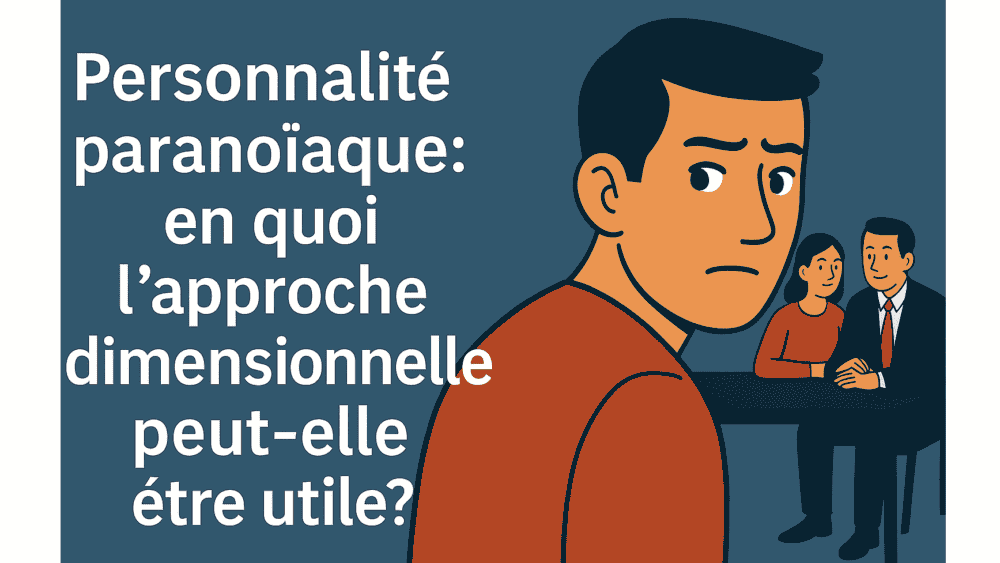Dans un contexte professionnel où les organisations sont de plus en plus sensibles à la qualité des relations de travail, les personnalités dites “difficiles” représentent un enjeu majeur. Parmi elles, la personnalité paranoïaque en entreprise suscite un intérêt particulier, tant elle peut déstabiliser les équilibres relationnels, créer des tensions persistantes et altérer la confiance mutuelle. L’approche traditionnelle, fondée sur une classification rigide des troubles, montre aujourd’hui ses limites. L’émergence d’une approche dite “dimensionnelle”, plus souple et nuancée, offre de nouvelles perspectives pour mieux comprendre et accompagner ces profils en entreprise.
Définir la personnalité paranoïaque
Selon le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e édition ; American Psychiatric Association, 2013) et la Classification internationale des maladies (11e révision ; Organisation mondiale de la santé, 2022), la personnalité paranoïaque se caractérise par une méfiance excessive et injustifiée à l’égard des autres, une interprétation malveillante de leurs intentions, une rigidité dans les relations et une tendance à ruminer des griefs. En entreprise, cela peut se traduire par : une hypersensibilité aux critiques, une difficulté à faire confiance, une tendance à percevoir les feedbacks comme des attaques, ou encore un isolement relationnel. Il est important de distinguer cette personnalité d’un trouble psychiatrique aigu comme la paranoïa délirante, qui relève d’une prise en charge médicale.
Des recherches récentes (Jacobs, 2024 ; Jain & Torrico, 2024) ont approfondi la compréhension du trouble paranoïaque de la personnalité, en insistant notamment sur les altérations cognitives (biais attentionnels, rigidité interprétative) et les pistes thérapeutiques innovantes comme la thérapie interpersonnelle métacognitive (Cheli et al., 2021).
Limites de l’approche catégorielle dans l’accompagnement
L’approche catégorielle, dominante dans les diagnostics cliniques, a pour effet de figer les personnes dans des “troubles” préétablis. Dans le cadre professionnel, cela peut mener à des pratiques d’étiquetage : “il/elle est parano”. Ce raccourci nie la complexité des parcours, des contextes et des émotions. Il empêche aussi d’envisager une évolution ou une adaptation des comportements. Enfin, cette approche tend à invisibiliser le vécu psychique de la personne, au profit d’une logique de contrôle des comportements perturbateurs.
Apports de l’approche dimensionnelle
L’approche dimensionnelle propose de comprendre les traits de personnalité non comme des catégories fixes, mais comme des spectres d’intensité variable. La méfiance, par exemple, n’est pas en soi pathologique : elle peut être adaptative dans certains contextes professionnels où la prudence est de mise. Cette approche met en lumière des forces associées aux traits paranoïaques : vigilance, sens de la justice, loyauté, résistance à la manipulation. Elle permet aussi de sortir d’une vision binaire normal/pathologique, et de considérer la personnalité comme un ensemble dynamique, en interaction avec l’environnement.
Conséquences pratiques pour l’accompagnement en entreprise
- Repérer sans pathologiser : il s’agit d’identifier des signes de méfiance excessive ou de retrait sans en faire immédiatement un diagnostic. Former les managers à repérer des styles relationnels plutôt que des “troubles” permet de créer des conditions de dialogue plus sereines.
- Travailler sur les représentations et les biais d’interprétation : les personnes ayant des traits paranoïaques interprètent souvent les événements de façon hostile. Un accompagnement centré sur la communication non violente, la reformulation ou la médiation peut les aider à reconstruire des grilles de lecture plus apaisées.
- Renforcer le cadre de confiance : la méfiance se développe dans les zones d’ambiguïté. Il est essentiel de poser un cadre clair, prévisible, traçable. Le contrat psychologique (ensemble des attentes implicites entre l’entreprise et le salarié) doit être rendu explicite autant que possible.
- Valoriser le potentiel plutôt que neutraliser le risque : plutôt que de chercher à “corriger” ou faire taire les traits difficiles, il est plus pertinent de les canaliser. Une vigilance accrue peut devenir une force dans des fonctions de contrôle, d’audit ou de sécurité, à condition que le cadre relationnel soit sécurisé.
Enjeux éthiques et limites
L’approche dimensionnelle, bien qu’innovante, impose une vigilance éthique : respecter la vie privée, ne pas dériver vers une pathologisation généralisée des comportements, articuler les dispositifs internes avec les professionnels de santé lorsque la situation le justifie.
Conclusion
Face aux limites de l’approche catégorielle, l’approche dimensionnelle ouvre une voie nouvelle pour accompagner de façon plus fine et plus humaine les personnalités paranoïaques en entreprise. Elle permet de sortir d’une logique de stigmatisation pour entrer dans une logique de transformation durable, fondée sur la compréhension des fonctionnements psychiques, l’aménagement des environnements de travail et la valorisation du potentiel humain.
Pour approfondir ce sujet, vous pouvez consulter les deux premiers articles de cette série : Personnalités difficiles en entreprise : de l’étiquette au sur-mesure et Personnalités difficiles : de la pathologie au potentiel, comment accompagner une transformation durable.
Et vous pouvez également suivre la formation d’ALYZO sur le Management des travailleurs en situation de handicap psychique.
Sources
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5e éd.). Washington, DC : APA.
- Organisation mondiale de la santé. (2022). Classification internationale des maladies, 11e révision (CIM-11). Genève : OMS.
- Bernstein, D. P., Useda, J. D., Siever, L. J., & Siever, L. J. (1998). Paranoid personality disorder. In T. Millon et al. (Eds.), Personality Disorders in Modern Life (pp. 122–157). New York : Wiley.
- Jacobs, K. A. (2024). Changes of intuition in paranoid personality disorder. Frontiers in Psychiatry, 14, 1307629.
- Jain, L., & Torrico, T. J. (2024). Paranoid Personality Disorder. In StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
- Cheli, S., Cavalletti, V., Popolo, R., & Dimaggio, G. (2021). A case study on a severe paranoid personality disorder client treated with metacognitive interpersonal therapy. Journal of Clinical Psychology.
Questions-réponses
Comment distinguer une personnalité paranoïaque d’un comportement passager de méfiance ?
La personnalité paranoïaque implique une méfiance constante et généralisée, souvent enracinée de longue date. En revanche, un comportement méfiant peut être contextuel et transitoire, lié à une situation particulière.
Est-il possible d’aménager un poste pour une personne avec des traits paranoïaques ?
Oui. Un poste avec des règles claires, peu d’ambiguïtés, et des interactions prévisibles peut réduire les tensions et permettre à la personne de mobiliser ses compétences dans un cadre sécurisant.
Quelle posture adopter en tant que manager face à une personne très méfiante ?
Il est essentiel d’adopter une communication transparente, cohérente et sans double message. La constance managériale et la clarification des attentes sont déterminantes.
L’approche dimensionnelle est-elle reconnue dans les pratiques professionnelles ?
Oui, elle est de plus en plus intégrée, notamment dans les approches transdiagnostiques en psychologie clinique. Elle permet une lecture plus nuancée des comportements, en complément des classifications classiques.
Faut-il faire appel à un psychologue du travail dans ce type de situation ?
Oui, en particulier lorsque la situation se chronicise ou affecte les collectifs. Un psychologue peut aider à décoder les dynamiques relationnelles et à proposer des stratégies d’ajustement adaptées.