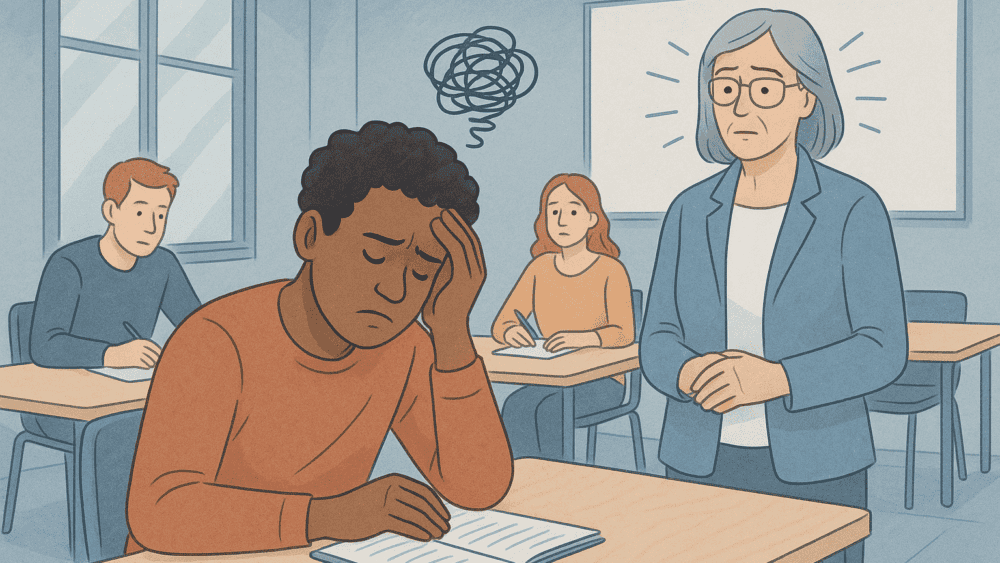Dans les organismes de formation, les équipes sont de plus en plus souvent confrontées à des situations d’apprenants en difficulté persistante, sans qu’un diagnostic formel n’ait été posé. Parmi les causes fréquentes, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) occupe une place singulière : peu visible, souvent non diagnostiqué à l’âge adulte, il génère des obstacles importants à l’apprentissage et à l’organisation personnelle.
Face à ce défi, le Référent Handicap ne peut être seul. Si son rôle de coordination est essentiel, la détection précoce de ces profils repose sur une vigilance collective, impliquant formateurs, conseillers pédagogiques, personnels d’accueil et administratifs. Cet article a pour objectif d’outiller ces professionnels en leur proposant une grille d’observation partagée, une clarification du cadre juridique, ainsi que des bonnes pratiques pour agir sans stigmatiser, et toujours dans l’intérêt de l’apprenant.
Comprendre le TDAH chez l’adulte : manifestations spécifiques en formation
Avant d’apprendre à repérer les signaux en formation, encore faut-il comprendre comment le TDAH se manifeste à l’âge adulte, et pourquoi ces manifestations passent souvent inaperçues si l’on ne connaît pas ce trouble.
Le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) est souvent perçu comme un trouble de l’enfance. Pourtant, il persiste à l’âge adulte chez environ deux tiers des personnes concernées dans l’enfance. Les manifestations évoluent : l’hyperactivité physique peut laisser place à une agitation mentale permanente, et l’impulsivité se manifeste plus souvent dans la gestion des émotions, des prises de parole ou des décisions hâtives.
Chez l’adulte en formation, les signes sont plus discrets mais bien présents. L’inattention se traduit par des décrochages pendant un cours, une tendance à « décrocher » mentalement, ou une grande difficulté à suivre des consignes longues ou complexes. La désorganisation se manifeste par des oublis récurrents (matériel, échéances), une mauvaise gestion du temps ou encore une tendance à commencer plusieurs tâches sans en terminer aucune.
Ces manifestations ont des répercussions concrètes en formation : retards fréquents, difficultés à rendre les travaux dans les délais, découragement face à des tâches séquentielles, ou tendance à poser des questions qui semblent décalées. Dans un module de 3 heures, un adulte avec TDAH peut par exemple être très actif pendant la première demi-heure, puis progressivement se désengager sans que cela soit volontaire.
Il est essentiel que les équipes en charge des apprenants adultes prennent en compte ces spécificités pour éviter des interprétations erronées : ce n’est ni de la mauvaise volonté, ni un manque de motivation, mais une manifestation cognitive durable qui nécessite des ajustements ciblés.
Une fois ce profil mieux compris, il devient possible de distinguer les signaux faibles et flagrants du TDAH en situation de formation. Mais ces indices doivent être lus de manière collective et contextualisée.
Quels sont les signes d’alerte observables en formation ?
Repérer un TDAH chez un adulte en formation repose avant tout sur l’observation fine de comportements récurrents. Ces comportements ne sont pas spécifiques ou exclusifs au TDAH (c’est-à-dire qu’ils peuvent apparaître dans d’autres contextes), mais leur accumulation doit alerter.
Les signes d’alerte peuvent être classés en deux catégories : les signaux faibles, souvent discrets et interprétables de différentes manières, et les signaux flagrants, plus visibles et susceptibles de générer des tensions ou des incompréhensions au sein du groupe de formation ou de l’équipe.
Les signaux faibles
Ce sont des manifestations qui, prises isolément, peuvent passer inaperçues ou être attribuées à la fatigue, au stress ou à un défaut d’organisation passager. Il s’agit par exemple :
- d’une tendance à perdre le fil lors d’une explication ;
- de fautes d’inattention répétées sur des consignes simples ;
- d’une agitation corporelle discrète mais persistante (bouger les jambes, tapoter un stylo, changer fréquemment de position) ;
- d’une fatigue cognitive en fin de séquence, avec des signes de désengagement ou d’absence.
Les signaux flagrants
Plus marqués, ils s’inscrivent dans la durée et peuvent freiner le déroulement de la formation :
- retards chroniques et oublis de matériel ;
- discours auto-dévalorisant du type : « je n’y arrive jamais », « je suis nul pour m’organiser » ;
- production écrite décousue, inachevée ou très en décalage avec la consigne donnée ;
- interruptions fréquentes ou prises de parole impulsives.
Ces signes, bien qu’hétérogènes, dessinent un profil lorsqu’ils sont récurrents. Leur repérage est facilité par une coordination entre les différents acteurs de la formation. Le tableau ci-dessous synthétise ces éléments.
| Type de signal | Manifestation possible | Acteur susceptible de le repérer |
| Signal faible | Oubli de consignes, distraction en cours | Formateur, coordinateur pédagogique |
| Signal faible | Agitation motrice discrète, fatigue en fin de module | Formateur, surveillant, tuteur |
| Signal faible | Difficulté à suivre une procédure, lenteur dans les tâches | Référent pédagogique, responsable d’atelier |
| Signal flagrant | Retards répétés, absences imprévues | Équipe administrative, responsable de groupe |
| Signal flagrant | Discours d’autodépréciation, stress visible | Référent Handicap, formateur, psychologue |
| Signal flagrant | Travail décousu, manque de logique dans les productions | Formateur référent, évaluateur |
En croisant les observations de terrain et en instaurant un climat bienveillant, les équipes pédagogiques peuvent identifier les besoins spécifiques des apprenants avec TDAH et enclencher un accompagnement adapté, sans diagnostic formel préalable.
Le Référent Handicap joue alors un rôle de tiers facilitateur. Il ne pose pas de diagnostic, mais il peut organiser l’écoute, centraliser les observations et proposer des ajustements raisonnables.
Le rôle du Référent Handicap dans le repérage du TDAH
Le Référent Handicap joue un rôle clé dans l’identification précoce d’un trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez un apprenant adulte, sans pour autant se substituer à un professionnel de santé. Sa mission commence par une posture d’écoute active, dénuée de jugement ou d’interprétation hâtive. Lorsqu’un apprenant évoque des difficultés à suivre le rythme, à se concentrer ou à organiser son travail, il ne s’agit pas d’établir un diagnostic, mais de recueillir ces éléments dans un climat de confiance.
L’entretien de positionnement constitue un moment stratégique. Le Référent peut y glisser des questions indicatives, sans portée médicale, mais qui ouvrent la réflexion : « Avez-vous parfois l’impression d’oublier rapidement ce que vous venez de lire ? », « Vous arrive-t-il de vous sentir débordé malgré vos efforts d’organisation ? », « Le travail en groupe vous semble-t-il difficile à cause d’un besoin de vous recentrer souvent ? » Ces formulations permettent d’identifier des indices de TDAH sans stigmatiser ni enfermer.
Par ailleurs, le Référent Handicap agit comme un pivot entre les acteurs de la formation : il recoupe les observations de l’équipe pédagogique (inattention, décrochage, agitation) et de l’équipe administrative (absences, retards fréquents), ce qui renforce la qualité du repérage.
Enfin, il peut orienter l’apprenant vers des ressources externes adaptées : consultation en centre de santé, appui par un partenaire Cap emploi, ou accompagnement spécialisé. Il peut aussi proposer un premier niveau d’aménagement pédagogique, sans attendre un diagnostic formel, dans une logique de compensation souple et réversible.
Pour autant, il n’agit pas seul. La détection du TDAH nécessite une culture d’équipe, où chacun peut contribuer à la remontée d’éléments utiles sans jugement hâtif.
Mobiliser l’ensemble de l’équipe pour une détection partagée
Le repérage du TDAH en formation ne peut reposer sur le seul Référent Handicap : il nécessite l’implication concertée de l’ensemble de l’équipe de l’organisme de formation. Chacun, à son niveau, peut contribuer à détecter des signaux faibles ou récurrents et à alerter de manière constructive, dans une logique bienveillante et non stigmatisante.
Les formateurs sont en première ligne. Ils peuvent remarquer des comportements récurrents : un apprenant qui coupe la parole sans s’en rendre compte, qui oublie systématiquement ses supports, qui se disperse pendant les exercices ou qui présente des difficultés à structurer sa pensée. Une pédagogie d’observation permet de remonter ces éléments au Référent Handicap, en prenant soin de ne pas les interpréter de façon hâtive, mais comme des faits potentiellement utiles à une meilleure adaptation du parcours.
Le personnel administratif, souvent en contact en amont de la formation, peut également contribuer : un dossier d’inscription incomplet, des documents oubliés à plusieurs reprises, des délais systématiques dans les réponses sont autant d’indices qui, s’ils se répètent, méritent d’être notés et partagés.
Pour rendre ce travail collectif possible, il est essentiel de créer une culture inclusive au sein de l’OF. Cela passe par une sensibilisation minimale de toute l’équipe aux troubles cognitifs comme le TDAH, et par l’instauration d’un climat où la question des besoins spécifiques peut être abordée sans tabou.
Un bon levier consiste à formaliser un protocole de repérage informel : un document partagé permettant de consigner de manière neutre les observations pédagogiques et organisationnelles. Ce protocole ne vise pas à diagnostiquer, mais à poser les bonnes questions et à enclencher, si besoin, une discussion individualisée avec l’apprenant.
Ce que l’on peut faire sans diagnostic médical : repérer, accompagner, orienter
Et lorsqu’aucun diagnostic médical n’est établi, que peut-on faire ? Dans ce cas, l’organisme de formation conserve des marges de manœuvre importantes, à condition de respecter un cadre pédagogique et éthique clair.
Dans certaines situations, l’organisme de formation est destinataire d’un avis médical (fourni par le service médical universitaire, le médecin traitant ou un service de prévention et de santé au travail, un neuropsychologue, etc.), accompagné d’une reconnaissance administrative du handicap (RQTH). Ces documents permettent de mettre en œuvre des aménagements ciblés dans un cadre juridique clairement balisé : temps majoré, support adapté, assistance humaine, etc. L’équipe pédagogique peut alors s’appuyer sur ces préconisations pour ajuster les conditions de formation, sans être tenue d’interpréter les causes médicales.
Mais d’autres situations appellent une démarche d’observation et d’adaptation, même en l’absence de diagnostic. Un formateur remarque, par exemple, qu’un apprenant présente des retards chroniques, des oublis répétés, une agitation importante et une difficulté à structurer ses productions. Ces éléments, recoupés par l’équipe administrative (dossier d’inscription incomplet, difficulté à respecter les échéances), constituent des signaux cohérents. Sans porter de jugement médical, l’équipe met alors en place des aménagements pédagogiques simples : envoi des supports en amont, reformulation écrite des consignes, évaluation orale.
La réussite de l’apprenant dans ces conditions nouvelles peut justifier une invitation à envisager une reconnaissance administrative du handicap. Cette démarche permet de pérenniser les ajustements, en protégeant à la fois l’apprenant (accès sécurisé à ses droits) et l’organisme (équité de traitement entre stagiaires). Si les aménagements sont généralisables (accessibilité des supports, consignes clarifiées), ils peuvent naturellement bénéficier à l’ensemble du groupe sans distinction.
Conclusion
Repérer un trouble tel que le TDAH dans un organisme de formation ne signifie pas diagnostiquer, ni étiqueter. C’est préparer un terrain favorable à la réussite, par l’observation bienveillante, l’écoute active et l’expérimentation d’aménagements simples. En impliquant toutes les parties prenantes, l’organisme crée une dynamique inclusive, où chaque difficulté devient une opportunité d’adaptation. Le Référent Handicap est alors un acteur pivot, mais il ne peut réussir sans le soutien de l’équipe tout entière. Développer cette vigilance partagée, c’est renforcer la qualité de l’accompagnement proposé à tous les publics — avec ou sans handicap reconnu.
Bibliographie
Questions-Réponses
Peut-on repérer un TDAH chez un apprenant adulte sans diagnostic médical ?
Oui. Il est tout à fait possible d’observer des indices comportementaux évocateurs d’un TDAH (inattention, désorganisation, impulsivité, agitation) en situation de formation. L’objectif n’est pas de poser un diagnostic, mais de proposer des ajustements pédagogiques raisonnables qui facilitent l’apprentissage. Ces observations peuvent ensuite, avec l’accord de l’apprenant, conduire à une orientation vers un professionnel de santé si nécessaire.
Quels sont les signes d’un TDAH chez un adulte en formation ?
Les signes les plus fréquents sont : des retards chroniques, une grande difficulté à prioriser les tâches, des oublis répétés, une production décousue malgré l’implication, ou encore un discours auto-dévalorisant. Il peut également s’agir de signaux faibles comme des erreurs d’inattention, une dispersion mentale ou une fatigue cognitive importante.
Le Référent Handicap peut-il proposer des aménagements sans justificatif médical ?
Oui, sous certaines conditions. Si les besoins sont identifiés avec l’apprenant, des aménagements pédagogiques peuvent être mis en place même en l’absence de reconnaissance officielle de handicap. Cela relève du bon sens pédagogique et peut être documenté comme une mesure temporaire. Toutefois, une reconnaissance formelle (RQTH) est souvent utile pour sécuriser ces ajustements dans la durée.
Qui, dans un organisme de formation, peut alerter sur un possible TDAH ?
Tout professionnel en lien avec l’apprenant : formateurs, coordinateurs pédagogiques, personnel administratif, conseillers en insertion, etc. Les difficultés peuvent apparaître dès l’inscription (dossiers incomplets, délais prolongés), lors des sessions (retards, fatigue, agitation) ou dans les échanges informels. Une vigilance partagée permet d’agir plus vite et plus justement.
Comment aborder le sujet avec l’apprenant sans stigmatiser ?
Il est recommandé d’ouvrir le dialogue à partir des difficultés observées, en adoptant une posture bienveillante et non médicale. Par exemple : « J’ai remarqué que vous semblez rencontrer des difficultés à vous organiser ou à rester concentré longtemps. Souhaitez-vous qu’on explore ensemble des aménagements pour vous aider à mieux suivre la formation ? ». L’écoute active, la confidentialité et l’absence de jugement sont essentielles.