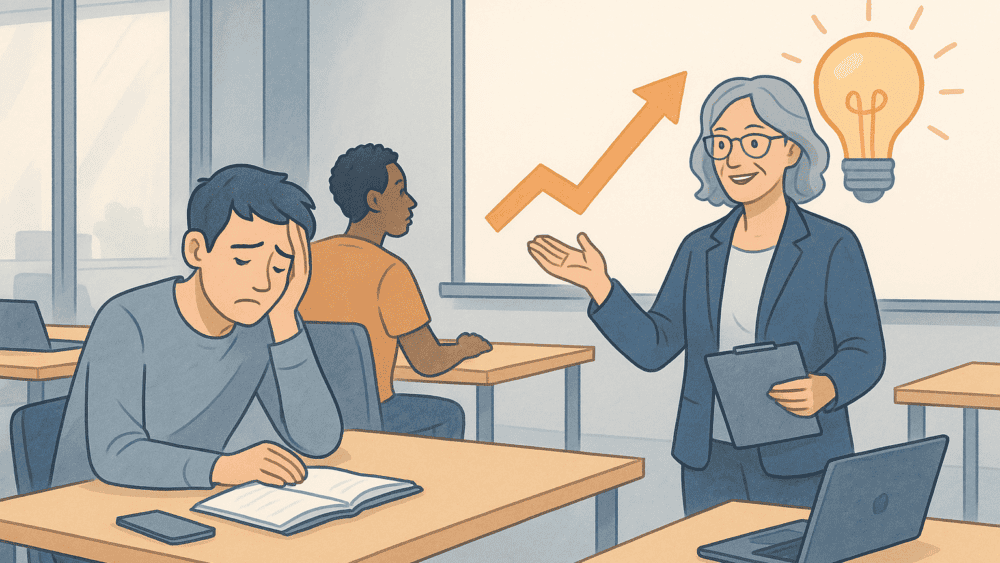Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est une condition neurodéveloppementale qui touche entre 3 et 5 % des adultes, selon les estimations les plus courantes (source : INSERM, 2021). S’il est désormais mieux reconnu dans le monde de l’enfance et de la scolarité, il reste encore insuffisamment pris en compte dans les dispositifs de formation pour adultes, en particulier dans les organismes de formation (OF). Pourtant, de nombreux adultes en situation de TDAH s’engagent dans des parcours de formation, qu’ils soient en reconversion, demandeurs d’emploi, salariés ou bénéficiaires de dispositifs d’insertion.
Pour ces apprenants, le TDAH peut constituer un frein significatif à l’apprentissage si aucun aménagement n’est prévu. Inattention, distractibilité, impulsivité ou agitation sont autant de manifestations qui peuvent perturber leur rapport au savoir et les mettre en difficulté, non pas du fait d’un manque de compétences, mais en raison d’un environnement peu adapté à leurs besoins cognitifs.
Cet article propose d’identifier les impacts concrets du TDAH sur les apprentissages et de recenser les leviers d’action pertinents pour les organismes de formation, afin de favoriser un parcours d’apprentissage équitable, motivant et efficace pour ces publics.
Les spécificités cognitives du TDAH et leurs conséquences en formation
Pour comprendre comment agir, il est nécessaire de commencer par cerner les particularités cognitives associées au TDAH chez l’adulte, et leurs répercussions concrètes sur les apprentissages.
Chez l’adulte, le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) se manifeste par un profil cognitif singulier, avec des répercussions concrètes en situation de formation. Ces personnes alternent entre des phases d’hyperconcentration sur des sujets d’intérêt et des périodes de distractibilité extrême. Par exemple, un apprenant peut passer deux heures absorbé par un exercice de graphisme, mais décrocher en quelques minutes lors d’un module théorique perçu comme peu stimulant. Les troubles de la mémoire de travail rendent difficile la gestion d’informations multiples : lors d’un exercice pratique, il peut oublier une étape essentielle après avoir lu l’ensemble des consignes. Les difficultés d’organisation et de planification provoquent des retards dans la remise des travaux, des oublis de matériel ou des rendez-vous manqués. Enfin, l’impulsivité comportementale peut entraîner des prises de parole inappropriées ou des réactions perçues comme désinvoltes, alors qu’elles sont involontaires. Ces manifestations, mal comprises, peuvent mener à un sentiment de dévalorisation, voire d’échec, chez l’apprenant, et à des tensions avec l’équipe pédagogique si aucun aménagement n’est prévu.
Adapter le cadre de la formation : un levier d’inclusion
Ces spécificités cognitives appellent des ajustements pédagogiques ciblés. Adapter le cadre de la formation devient alors un levier d’inclusion incontournable pour éviter l’échec ou le décrochage.
Face aux besoins spécifiques des adultes avec TDAH, adapter le cadre de la formation est un levier essentiel pour garantir leur inclusion. De l’adaptation des supports pédagogiques à l’aménagement des examens, le champ d’actions est large. Le plus souvent, il ne s’agit pas de transformer radicalement l’organisation, mais d’introduire des ajustements simples et ciblés, qui peuvent bénéficier à tous les apprenants.
Environnement physique et temporel
Les personnes avec TDAH ont besoin de pauses régulières pour éviter la surcharge cognitive. Dans une formation de 3 heures, prévoir un arrêt toutes les 45 minutes peut permettre à l’apprenant de mieux gérer son attention. Par ailleurs, certains ont besoin d’un espace calme pour s’isoler, par exemple pour relire une consigne ou effectuer un exercice sans stimulation excessive. Les séquences courtes, de 20 à 30 minutes, favorisent également la concentration en évitant les longues périodes statiques.
Accès à l’information
Le TDAH altérant parfois la compréhension immédiate, il est important de multiplier les canaux de transmission. Une consigne écrite appuyée par un schéma ou une explication orale est plus facilement intégrée. Par exemple, un apprenant pourra mieux assimiler une procédure s’il peut la lire sur un support, l’écouter en même temps et la revoir via un enregistrement audio mis à disposition. Cela évite aussi la perte d’informations en cas de décrochage momentané.
Flexibilité organisationnelle
Certains adultes avec TDAH expriment mieux leurs compétences à l’oral qu’à l’écrit, ou ont besoin de plus de temps pour structurer leur pensée. Il est donc pertinent de diversifier les modalités d’évaluation : proposer, au choix, une présentation orale, un quiz visuel, ou un travail écrit guidé. Pour les modules en ligne, l’asynchrone permet une meilleure gestion du rythme : un apprenant qui peine à se concentrer à 14 h pourra consulter la séquence le soir, lorsqu’il est plus disponible.
Ces adaptations, simples à mettre en œuvre, renforcent non seulement l’équité entre les apprenants, mais favorisent aussi un climat pédagogique plus inclusif, bénéfique à l’ensemble du groupe.
Outiller les formateurs et l’équipe pédagogique
Mais l’aménagement matériel ne suffit pas. C’est l’équipe pédagogique, en interaction directe avec les apprenants, qui détient un rôle clé dans la réussite de ces adaptations.
Les équipes pédagogiques jouent un rôle central dans la réussite des apprenants avec TDAH. Une formation de sensibilisation permet de sortir des idées reçues : un adulte distrait ou désorganisé n’est pas nécessairement démotivé, mais peut simplement rencontrer des obstacles cognitifs liés à son trouble. Comprendre la notion d’inhibition, les troubles de l’attention ou l’hyperactivité mentale aide à ajuster les pratiques : autoriser à bouger discrètement, reformuler une consigne, proposer des supports allégés.
L’individualisation du parcours passe par la désignation d’un référent (formateur ou référent handicap) capable de construire avec l’apprenant un accompagnement personnalisé. Par exemple, aménager les échéances d’un devoir ou planifier des points de suivi réguliers permet de sécuriser le parcours. L’évaluation continue de ces ajustements, avec le retour de l’apprenant, garantit leur efficacité sans stigmatiser.
Encourager les stratégies compensatoires
En complément de l’accompagnement pédagogique, il est essentiel d’aider les apprenants à développer des stratégies compensatoires leur permettant de renforcer leur autonomie.
Favoriser la réussite des adultes avec TDAH ne repose pas uniquement sur l’adaptation du cadre de formation. Il s’agit aussi d’aider les apprenants à développer leurs propres stratégies compensatoires, pour gagner en autonomie et transférer ces compétences dans leur vie professionnelle et personnelle.
Les outils numériques peuvent être des alliés puissants : un simple minuteur visuel (comme “Time Timer” ou “Pomofocus”) aide à structurer les sessions de travail et à maintenir l’attention sur de courtes périodes. Les applications de rappel comme “Google Tasks”, “Trello” ou “Notion” permettent de gérer les tâches à effectuer, avec des notifications personnalisées. Par exemple, un stagiaire en formation continue a appris à programmer chaque soir un récapitulatif de ses tâches pour le lendemain, ce qui lui a permis de réduire considérablement ses oublis et retards.
La prise de notes structurée est un autre levier. L’utilisation de techniques visuelles comme le mind mapping (cartes mentales) permet à l’apprenant de visualiser et organiser les informations plus efficacement qu’avec des notes linéaires. Un formateur en bureautique a ainsi proposé à un stagiaire avec TDAH de résumer les étapes d’un processus informatique sous forme de carte mentale illustrée : ce format lui a permis de mieux comprendre et mémoriser les manipulations complexes.
Les supports synthétiques, comme des fiches-mémo, sont aussi essentiels. Ils permettent à l’apprenant de retrouver l’essentiel rapidement sans avoir à relire l’intégralité du cours. L’utilisation d’icônes, de couleurs ou de schémas est particulièrement adaptée à ceux qui ont une mémoire visuelle dominante.
Enfin, le travail en binôme ou en petit groupe favorise l’entraide et la clarification des consignes. Un apprenant avec TDAH pourra bénéficier du regard d’un pair pour relire un énoncé, vérifier sa compréhension ou reformuler une consigne ambiguë. Dans un centre de formation aux métiers de l’aide à la personne, la mise en place d’un système de “binôme bienveillant” a permis à plusieurs stagiaires en difficulté cognitive de progresser plus sereinement.
Encourager l’adoption de ces stratégies suppose aussi que les formateurs soient prêts à les recommander, à les valoriser et à les intégrer dans les pratiques pédagogiques. Cela participe à créer un environnement qui soutient les compétences exécutives et favorise l’estime de soi.
Identifier les ressources mobilisables
Au-delà des ressources internes à l’organisme de formation, il est également utile de s’appuyer sur des dispositifs et partenaires extérieurs pour renforcer l’accompagnement.
Les organismes de formation peuvent s’appuyer sur un réseau de ressources externes :
- Le Service de santé au travail si le bénéficiaire est salarié.
- Les Cap Emploi ou les missions locales pour les demandeurs d’emploi.
- Les MDPH pour les droits à compensation.
- Les associations spécialisées (comme HyperSupers ou TDAH France) pour de l’information ou du soutien individuel.
Évaluer et ajuster : une logique d’amélioration continue
Enfin, toute démarche inclusive gagne à être réévaluée régulièrement. Les aménagements doivent évoluer avec les besoins de l’apprenant et les réalités du parcours.
Un aménagement pédagogique doit être envisagé comme une hypothèse à tester, et non comme une solution définitive. Ce principe implique une démarche d’évaluation continue et collaborative. Il est essentiel d’associer l’apprenant à cette évaluation : en recueillant ses retours sur ce qui l’aide ou le freine, on affine les ajustements possibles. Par exemple, un apprenant peut constater qu’il gère mieux sa concentration en suivant le cours à distance plutôt qu’en présentiel : c’est un signal à prendre en compte. Des points de suivi réguliers — toutes les 2 à 4 semaines — permettent d’ajuster le plan d’accompagnement en fonction de l’évolution des besoins, des contenus abordés ou du niveau de fatigue. Il est aussi recommandé de documenter les expériences, en conservant une trace des aménagements testés et de leur efficacité. Cela constitue une base utile pour les équipes pédagogiques, et un levier de montée en compétences collective.
Conclusion
Adapter un parcours de formation à un apprenant avec TDAH ne relève pas d’un traitement de faveur, mais d’un acte professionnel qui reconnaît la diversité des profils cognitifs. En aménageant l’environnement, en formant les équipes pédagogiques, et en valorisant les stratégies compensatoires, les organismes de formation créent un cadre d’apprentissage plus souple, plus humain, et plus efficace. Ces ajustements, souvent simples à mettre en œuvre, profitent à tous les apprenants, en particulier à ceux qui rencontrent des difficultés d’attention ou d’organisation, même sans diagnostic. C’est ainsi que l’on construit une pédagogie véritablement inclusive. Pour en savoir plus, suivez la formation d’ALYZO pour le Référent Handicap et l’équipe de formation
Bibliographie
Questions-Réponses
Qu’est-ce que le TDAH et comment impacte-t-il l’apprentissage chez l’adulte ?
Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental affectant l’attention, la concentration, la gestion du temps et les fonctions exécutives. Chez l’adulte en formation, il peut entraîner des difficultés à suivre des consignes, à s’organiser ou à rester attentif, ce qui nécessite des aménagements spécifiques.
Quels aménagements pédagogiques peuvent aider un apprenant avec TDAH ?
Parmi les plus efficaces : des supports structurés, des séquences courtes, un environnement calme, des pauses régulières, des évaluations adaptées et l’usage d’outils numériques de gestion du temps.
Un formateur doit-il adapter son approche face à un apprenant TDAH ?
Oui, il est recommandé de s’appuyer sur une posture bienveillante, de favoriser des consignes claires et de proposer des échanges réguliers pour adapter l’accompagnement en fonction des besoins.
Le TDAH donne-t-il droit à des aménagements officiels ?
Oui, si la personne a une reconnaissance de handicap (RQTH ou notification MDPH), elle peut bénéficier de mesures de compensation dans le cadre de la formation, avec l’appui du référent handicap.
Quelles ressources mobiliser pour accompagner un apprenant TDAH ?
Les organismes peuvent faire appel à des structures comme Cap Emploi, la MDPH, les missions locales ou des associations spécialisées. Le référent handicap joue un rôle clé pour orienter l’apprenant.